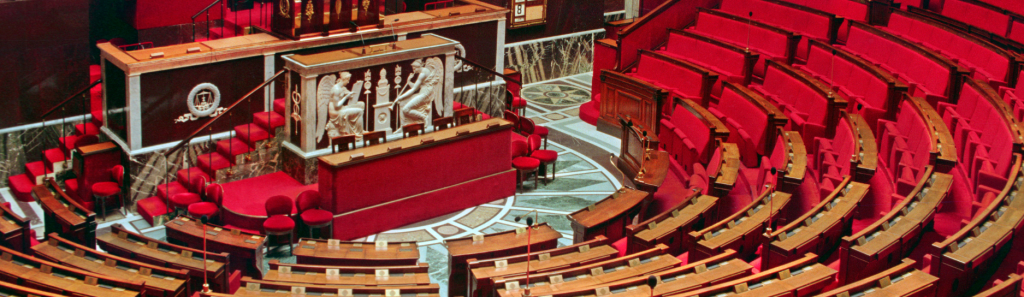Parce que le bio est à la fois une obligation et l’allié des maires, depuis 2019 l’Agence BIO est au Salon des Maires et des Collectivités Locales pour accompagner les élus en exercice et les futurs candidats à intégrer le bio au cœur de leurs politiques locales.
Le rendez-vous incontournable pour anticiper les municipales 2026 : pour rejoindre les communes qui font le bio en France, c’est du 18 au 20 novembre Porte de Versailles au pavillon 4 stand G 141.
le programme
MARDI 18 NOVEMBRE
- 11h – 14h : animation culinaire sur la restauration collective scolaire engagée avec Renaud Fourcade, chef de cantine en lycée (Occitanie).
- 14h30 – 17h : animation culinaire avec la communauté Ecotable et son chef Benjamin Schlumberger. L’association, sœur d’Ecotable, accélère la transition environnementale et sociale de la restauration commerciale en fédérant les professionnels engagés du secteur.
MERCREDI 19 NOVEMBRE
- 10h30 – 12h30 : ateliers de sensibilisation à l’alimentation durable avec l’Ecole comestible qui agit sur le territoire en collaboration avec les acteurs du milieu scolaire et péri-scolaire, ainsi qu’avec les acteurs publics locaux et nationaux.
- 12h30 – 13h15 : conférence “Au cœur des villes et villages, des repas bio pour tous les âges !” avec Anthony Beharelle de Croc la Vie, Laetitia Desvignes de Restoria, Blandine Zorel de la Mairie de Caluire-et-Cuire, et David Merdrignac de Biocoop Restauration, à l’Espace Atmosphère résilience agricole et alimentaire (voir le détail plus bas).
- 13h – 16h30 : animation culinaire sur la restauration collective scolaire engagée avec Francine Lioux, cheffe de cantine en collège (Ain). Francine Lioux a gagné ZeAward du meilleur engagement 2024 pour la restauration collective.
JEUDI 20 NOVEMBRE
- 11h – 14h et 15h – 17h : animation culinaire sur la place du bio en formation “hôtellerie restauration” avec les élèves du lycée hôtelier de Granville qui cuisineront toute la journée, sous la supervision de leur formateur Vincent Delacour.
la conférence
Cette conférence est organisée dans le cadre du programme CuisinonsPlusBio.fr.
De nombreuses collectivités locales organisent un service de restauration pour leurs habitants. Cette vocation sociale place aujourd’hui l’alimentation durable au cœur de l’action publique. La loi EGalim fixe d’ailleurs un objectif d’achat d’au moins 20% de produits bio en restauration collective.
Ces politiques alimentaires commencent dès le plus jeune âge, avec parfois l’organisation d’un service public de restauration en crèches qui répond aux préoccupations des parents, soucieux d’une alimentation saine et de qualité pour leurs enfants tout en répondant aux enjeux des premiers apprentissages sensoriels.
Les collectivités organisent ensuite l’offre de restauration de l’école maternelle jusqu’au lycée. La cantine continue d’être ainsi un lieu de sociabilisation par le partage d’un repas équilibré tout en restant un lieu de sensibilisation autour des enjeux du développement durable.
Enfin l’action sociale publique qui vise à lutter contre l’exclusion déploie également une offre alimentaire dans l’assiette de nos aînés et des plus fragiles. Les Centres Communaux ou Intercommunaux d’Action sociale (CCAS/CIAS) contribuent ainsi à lutter contre la dénutrition et l’isolement de nos aînés notamment par la gestion de maisons de retraite et la mise en place d’un service de portage de repas.
Cette conférence mettra en lumière les récentes initiatives qui traduisent la place de la cuisine de restauration collective au cœur de la pratique du changement vers une alimentation plus durable et comment l’offre de produits bio peut s’organiser aujourd’hui pour répondre à cette demande.
Les focus :
- La petite enfance (enjeux autour d’une offre de repas 100% bio, société à
mission, réseau, originalité du système de gestion) - L’éducation au cœur du bio réacteur (l’alimentation dans les écoles, la formation, la sensibilisation, la précarité alimentaire)
- La place des sociétés de restauration collective (présentation de l’offre scolaire
ainée, présentation de la stratégie de structuration des filières, la politique RSE) - L’approvisionnement en produit bio, comment faire pour en mettre plus et atteindre les objectifs de la loi EGalim (contrainte marché, approvisionnement local)